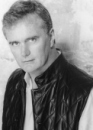L’assommoir.
L’assommoir.
Kenneth Cook nous retourne la tête en bas, chez nos voisins des antipodes, en Australie, le pays «down under» comme on dit là-bas.
Avec son troisième roman traduit en français, À coups redoublés, plutôt que tête en bas, c'est plutôt tête en vrac.
Tout se joue dans un pub-resto-pub-hôtel-pub-bordel-pub de la lointaine banlieue de Sydney entre quelques personnages : Mick le tenancier obèse du pub-resto-pub-... qui frelate discrètement ses doses de whisky aux côtés de sa grosse femme et de son gros chat, Peter un jeune gringalet qui espère bien séduire ce soir une jeune fille facile avec sa chemise et sa moto et John qui travaille du merlin à l'abattoir avant de venir se soûler au pub-resto-pub-... de Mick.
Chaque chapitre de ce petit bouquin (à peine plus de 100 pages) s'ouvre sur les minutes d'un procès. Car procès il y aura. Puisque victime il y aura.
Et chaque chapitre nous replonge dans ce qui s'est passé ce soir-là.
Pour décrire la beuverie du samedi soir quand tout le monde vient au pub-resto-pub-... de Mick écluser bières sur bières et autres alcools. Draguer et baisouiller. Castagner un peu aussi.
Sauf que ce soir-là, ça a mal tourné.
Ça ne pouvait que mal tourner. On le comprend dès les premières pages du bouquin. Quand Mick empoigne sa batte de base-ball dès qu'un client s'échauffe un peu. Quand John rentre de l'abattoir déjà ivre du plaisir qu'il a pris à assommer ses bœufs au merlin. Chronique annoncée d'une bagarre qui va mal finir.
Mais il faudra attendre la toute dernière page pour savoir qui a pris le coup fatal et ce bouquin pourrait bien figurer au rayon polars.
Sauf qu'il s'agit d'une étude de mœurs. L'étude sans concession de la profonde noirceur des mœurs des compatriotes de Kenneth Cook qui nous plonge la tête en bas dans un abime de bêtise, dans un gouffre de beaufitude.
L'immensité des territoires australiens et l'immensité du vide des vies de ces gens-là semblent propices à l'épanouissement de l'immensité de la bêtise la plus crasse. C'est noir et c'est froid.
Précisément, ce froid c'est aussi celui de l'écriture de K. Cook qui nous raconte tout cela du ton détaché de l'entomologiste qui vous montre la mouche qui tourne en rond dans son bocal jusqu'à se péter la figure sur le verre (de bière). Plus aucune humanité dans les personnages (tout est parti dans les chiottes en pissant la bière) mais plus d'humanité non plus dans l'écriture.
[...] Comme deux chiens qui s'entretuent pour établir leur suprématie, puis, une fois le vainqueur désigné, réalisent qu'ils n'ont plus besoin de se battre. Le chien dominant garderait toujours un air de supériorité envers le vaincu et resterait mal disposé à son égard, allant même jusqu'à lui montrer les dents à l'occasion, mais ils ne se battraient plus et cette certitude provoquait un certain réconfort chez les deux bêtes.
C'est noir, c'est froid et c'est terriblement désabusé.
Ce manque d'humanité résonne de façon glaciale dans l'immensité australienne.
Paradoxalement, l'écriture déshumanisée nous éloigne un peu plus de ces personnages lointains. Et ça nous touche moins.
Reste un pamphlet à distribuer gratuitement dans les débits de boisson ...
Pour celles et ceux qui aiment le noir et la bière.
Pitou en parle très bien, Cathe aussi.


 Revoici la reine de l'étrange avec deux recueils de nouvelles parus simultanément l'an passé :
Revoici la reine de l'étrange avec deux recueils de nouvelles parus simultanément l'an passé :  Ces
deux recueils qui se reflètent l'un dans l'autre sont tous deux
excellents et l'auteure y maîtrise parfaitement l'art de
l'étrange, du bizarre, de l'insolite. La moindre des situations
banales et quotidiennes prend très vite sous sa plume des allures
inquiétantes, sans que l'on sache trop où cela va nous mener.
Ces
deux recueils qui se reflètent l'un dans l'autre sont tous deux
excellents et l'auteure y maîtrise parfaitement l'art de
l'étrange, du bizarre, de l'insolite. La moindre des situations
banales et quotidiennes prend très vite sous sa plume des allures
inquiétantes, sans que l'on sache trop où cela va nous mener.
 La tête dans les étoiles.
La tête dans les étoiles. La lecture des mots.
La lecture des mots. Ce qu’on appelle broder une histoire.
Ce qu’on appelle broder une histoire. [...] « Cette année-là, à Aix, nous avons vu Cézanne plusieurs fois. Il paraissait si vieux. Je suis sûre qu'il ne se doutait pas qu'il allait mourir si peu de temps après. Il m'a montré des choses tellement merveilleuses sur les couleurs, et sur les formes aussi. Je peignais, en ce temps-là, voyez-vous. »
[...] « Cette année-là, à Aix, nous avons vu Cézanne plusieurs fois. Il paraissait si vieux. Je suis sûre qu'il ne se doutait pas qu'il allait mourir si peu de temps après. Il m'a montré des choses tellement merveilleuses sur les couleurs, et sur les formes aussi. Je peignais, en ce temps-là, voyez-vous. » Tintin au Tibet.
Tintin au Tibet. Trafic d'enfants et tension indo-chinoise à la frontière (et quelle frontière ! à plus de 6.000 mètres !) servent de toile de fond à cette petite enquête. Un voyage intéressant au pays des
Trafic d'enfants et tension indo-chinoise à la frontière (et quelle frontière ! à plus de 6.000 mètres !) servent de toile de fond à cette petite enquête. Un voyage intéressant au pays des 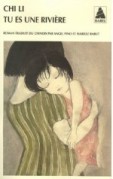



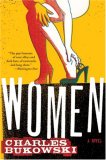














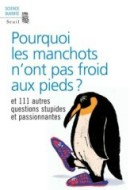
 Non, ce n'est pas encore un nième
polar polaire, mais en ce début d'année, alors que les
prix du pétrole flambent, alors que la politique épouse le
spectacle, alors que le chômage avance et que la retraite recule, alors
qu'il fait froid, ..., tout un chacun se pose légitimement des
questions, des questions, des questions ...
Non, ce n'est pas encore un nième
polar polaire, mais en ce début d'année, alors que les
prix du pétrole flambent, alors que la politique épouse le
spectacle, alors que le chômage avance et que la retraite recule, alors
qu'il fait froid, ..., tout un chacun se pose légitimement des
questions, des questions, des questions ...