 Du sang sur la neige.
Du sang sur la neige.
 Depuis janvier 2007 on attendait avec impatience la sortie du second tome de La légende des nuées écarlates, une superbe japonaiserie de l'italien Saverio Tenuta.
Depuis janvier 2007 on attendait avec impatience la sortie du second tome de La légende des nuées écarlates, une superbe japonaiserie de l'italien Saverio Tenuta. Les dessins (les peintures, devrait-on dire) sont absolument splendides et plutôt qu'un long discours, voici une planche du dernier volume et une autre du premier tome, avec ces images superbes qui rappellent bien entendu estampes et calligraphies japonaises. Trop beau !
Les dessins (les peintures, devrait-on dire) sont absolument splendides et plutôt qu'un long discours, voici une planche du dernier volume et une autre du premier tome, avec ces images superbes qui rappellent bien entendu estampes et calligraphies japonaises. Trop beau !
D'autres planches sont également visibles sur le site des Humanoïdes (derrière l'imagette à gauche).
Le scénario est riche et à la hauteur des dessins avec toute une alchimie complexe entre passé et présent.
L'histoire commence dans le Japon médiéval par un théâtre de bunraku puis la jeune marionnettiste doit prendre rapidement la fuite avec un ronin manchot, borgne et amnésique, en proie à des voix intérieures.
Le côté fantastique offre une belle toile de fond mais reste suffisamment discret pour ne pas étouffer l'histoire et les personnages qui vont peu à peu retrouver leur passé et ainsi nouer l'intrigue.
Le premier album plante le décor (magnifique) et les personnages (complexes).
Le second nous permet d'aller plus loin dans la connaissance de ces personnages, dans leur histoire et donc dans les relations qui les unissent depuis les drames du passé.
Voici un aperçu de la légende (ou ici en images) :
[...] - Douce Myobu, parle-moi de ton village encore une fois.
- Non, cette fois-ci, je vais vous raconter une autre histoire ...
Une histoire qui parle d'espoir.
Un jour, il y a longtemps, un petit garçon de mon village marchait dans la forêt de glace. Son petit loup et lui avaient perdu leur chemin.
Ils erraient depuis longtemps, épuisés et apeurés. Leur faim grandissait et l'enfant voyait avec désespoir son petit loup s'éteindre lentement.
Il prit son couteau, observa le métal brillant et prit sa décision.
Il enfonça la lame dans son visage. Un des propres yeux, c'était là l'unique repas que le garçon pouvait offrir.
Pas un gémissement ne sortit de sa bouche.
Sans comprendre, le louveteau affamé mangea pendant que l'enfant perdait ses forces.
Cependant, une ombre noire et terrifiante les observait.
Le lendemain, les gens du village retrouvèrent le petit corps recroquevillé parmi les feuilles.
Il était faible mais il vivait encore.
Lorsqu'il se réveilla, le petit garçon allait bien.
Seul un de ses yeux brillait d'un couleur différente. Mais avec le temps même cette nuance disparut.
L'imagerie japonaise est à la mode depuis plusieurs années dans le monde de la BD occidentale et ces Nuées écarlates sont celles des sommets, celle du sommet du Fuji San !
Les talents déployés par l'italien Saverio Tenuta rappellent inévitablement les dessins animés de Miyazaki avec ses chevauchées à dos de loups et l'envahissement du monde de l'homme par celui de la nature (ici la forêt de glace).
Les nuées écarlates en question c'est le nom des sabres du ronin : l'éclat du sang sur la neige, voilà qui s'avère ici particulièrement BDgénique.
Une autre critique ici.
Pour celles et ceux qui aiment le sang sur la neige.
 Année polaire.
Année polaire.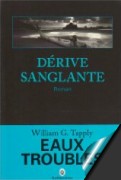
 Saga nordique.
Saga nordique. Deux chinoises au Tibet.
Deux chinoises au Tibet.
 Cette écriture-là ne nous a pas semblé avoir tout à fait la même force que les témoignages recueillis dans
Cette écriture-là ne nous a pas semblé avoir tout à fait la même force que les témoignages recueillis dans  Edvige, souriez ma chère, vous êtes fichée.
Edvige, souriez ma chère, vous êtes fichée.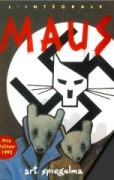



 Foutu marécage !
Foutu marécage ! Deuxième étage de la fusée littéraire sarde.
Deuxième étage de la fusée littéraire sarde. [...] Un jour Madame a pris son courage à deux mains, et a demandé à l'amant s'il l'aime un peu. Il a souri et il a dit qu'on n'aime pas un peu. Ou on aime, ou on n'aime pas. Madame était allongée sur le lit, nue à côté de lui, qui s'est relevé brusquement, s'est rhabillé, est passé dans la pièce d'à côté. Alors Madame a senti l'épouvante la frôler, elle s'est rhabillée aussi en se promettant de ne plus jamais poser de questions aussi idiotes. Des questions aussi idiotes détruisent toute la magie et, sans magie, la vie a un goût d'épouvante.
[...] Un jour Madame a pris son courage à deux mains, et a demandé à l'amant s'il l'aime un peu. Il a souri et il a dit qu'on n'aime pas un peu. Ou on aime, ou on n'aime pas. Madame était allongée sur le lit, nue à côté de lui, qui s'est relevé brusquement, s'est rhabillé, est passé dans la pièce d'à côté. Alors Madame a senti l'épouvante la frôler, elle s'est rhabillée aussi en se promettant de ne plus jamais poser de questions aussi idiotes. Des questions aussi idiotes détruisent toute la magie et, sans magie, la vie a un goût d'épouvante. Faux-frères.
Faux-frères.
 La guerre des polices.
La guerre des polices. Évidemment, la guerre des polices est un prétexte et Connelly jubile à mettre en scène les rivalités entre les apparatchiks hautains du FBI et le teigneux tenace du LAPD. On se régale.
Évidemment, la guerre des polices est un prétexte et Connelly jubile à mettre en scène les rivalités entre les apparatchiks hautains du FBI et le teigneux tenace du LAPD. On se régale. Et paf le chien.
Et paf le chien. Glaçant.
Glaçant. [...au téléphone ...] - J'appelle les troupes.
[...au téléphone ...] - J'appelle les troupes. Quand on a des sushis d’argent.
Quand on a des sushis d’argent. [...] - Mais qu'est-ce que vous faites ?
[...] - Mais qu'est-ce que vous faites ? Ni tout noir, ni tout blanc.
Ni tout noir, ni tout blanc.

 Les saints de glace.
Les saints de glace. [...] Rien ou presque n'a autant d'importance pour l'équipage que la nourriture. Uzbird pense que c'est parce qu'elle seule fournit un substitut plus ou moins valable à l'activité sexuelle. Cela mérite réflexion. Le fait est que l'inventivité du cuisinier lui assure la reconnaissance générale à bord. Les hommes vénèrent ainsi Green parce qu'il réussit à donner aux petits pois un léger arôme de menthe. je sais quant à moi que, pour les petits pois, il ajoute dans la casserole une giclée de dentifrice.
[...] Rien ou presque n'a autant d'importance pour l'équipage que la nourriture. Uzbird pense que c'est parce qu'elle seule fournit un substitut plus ou moins valable à l'activité sexuelle. Cela mérite réflexion. Le fait est que l'inventivité du cuisinier lui assure la reconnaissance générale à bord. Les hommes vénèrent ainsi Green parce qu'il réussit à donner aux petits pois un léger arôme de menthe. je sais quant à moi que, pour les petits pois, il ajoute dans la casserole une giclée de dentifrice. Quand jeunesse se passe.
Quand jeunesse se passe. [...] Chaque fois que je me rappelais le temps où ma sœur parlait encore, j'avais l'impression qu'une membrane venait m'envelopper. Elle parlait beaucoup, d'une voix fluette au timbre aigu. Quand on était enfants, l'une de nous deux s'arrangeait toujours pour émigrer avec son futon dans la chambre de l'autre, et on bavardait jusqu'à l'aube. On se jurait que plus tard on habiterait, elle ou moi, une maison avec lucarne. Ainsi on pourrait continuer nos bavardages en contemplant les étoiles au ciel. C'était une jolie promesse. Dans notre rêve, la vitre de la lucarne miroitait d'un éclat noir, les étoiles scintillaient comme des diamants, l'air était d'une grande pureté. Et les deux sœurs parlaient indéfiniment, sans se lasser, sans même imaginer que le matin allait revenir.
[...] Chaque fois que je me rappelais le temps où ma sœur parlait encore, j'avais l'impression qu'une membrane venait m'envelopper. Elle parlait beaucoup, d'une voix fluette au timbre aigu. Quand on était enfants, l'une de nous deux s'arrangeait toujours pour émigrer avec son futon dans la chambre de l'autre, et on bavardait jusqu'à l'aube. On se jurait que plus tard on habiterait, elle ou moi, une maison avec lucarne. Ainsi on pourrait continuer nos bavardages en contemplant les étoiles au ciel. C'était une jolie promesse. Dans notre rêve, la vitre de la lucarne miroitait d'un éclat noir, les étoiles scintillaient comme des diamants, l'air était d'une grande pureté. Et les deux sœurs parlaient indéfiniment, sans se lasser, sans même imaginer que le matin allait revenir. Chambre avec vue.
Chambre avec vue. [...] « Maître, lui dit Xiaohu, pourquoi toutes ces embrouilles ? Est-ce que, s'il n'y avait pas votre petite chambre ils s'abstiendraient de faire ce qu'ils font ? Sans elle, ils le feraient, ils le feraient au milieu des arbres, au milieu des tombes, les jeunes de maintenant préconisent le retour à la nature et c'est la mode faire ça dehors, et bien sûr ce n'est pas nous qui diront qu'ils ont tort, c'est humain. Je vous le dis depuis longtemps, faites comme si vous aviez simplement ouvert des W.-C. publics en pleine nature, que vous récoltiez un peu d'argent, c'est l'ordre naturel des choses, la raison est de votre coté. »
[...] « Maître, lui dit Xiaohu, pourquoi toutes ces embrouilles ? Est-ce que, s'il n'y avait pas votre petite chambre ils s'abstiendraient de faire ce qu'ils font ? Sans elle, ils le feraient, ils le feraient au milieu des arbres, au milieu des tombes, les jeunes de maintenant préconisent le retour à la nature et c'est la mode faire ça dehors, et bien sûr ce n'est pas nous qui diront qu'ils ont tort, c'est humain. Je vous le dis depuis longtemps, faites comme si vous aviez simplement ouvert des W.-C. publics en pleine nature, que vous récoltiez un peu d'argent, c'est l'ordre naturel des choses, la raison est de votre coté. » Exotisme nordique.
Exotisme nordique. Ce bouquin remporte dès la couverture deux palmes d'or : le titre et le patronyme les plus longs.
Ce bouquin remporte dès la couverture deux palmes d'or : le titre et le patronyme les plus longs. Quelques courtes nouvelles (à peine quelques pages parfois) parsemées d'un grain de folie et mettant en scène tantôt la solitude des êtres (des femmes souvent), tantôt des rencontres incertaines dont on ne sait trop ce qu'elles vont donner.
Quelques courtes nouvelles (à peine quelques pages parfois) parsemées d'un grain de folie et mettant en scène tantôt la solitude des êtres (des femmes souvent), tantôt des rencontres incertaines dont on ne sait trop ce qu'elles vont donner.