L’art de l’esquimautage.
Ah, prendre un bouquin d'Échenoz ! Ah, quelle annonce de plaisir. C'est comme décapsuler une bouteille de sa meilleure bière(1). C'est comme mettre un bon CD dans la boîte à zik.
Il faut dire que Jean Échenoz joue de la musique des mots comme d'autres de celle du piano.
Quel virtuose. Quelle mélodie que ces phrases qui tournent et qui roulent, l'humour discret, sans jamais se prendre trop au sérieux, sans effet d'orchestration trop appuyé.
Cette chanson-ci commence et finit par les mêmes mots, le même refrain : Je m'en vais.
On commence comme ceci :
Je m’en vais, dit Ferrer, je te quitte. Je te laisse tout mais je pars. Et comme les yeux de Suzanne, s’égarant vers le sol, s’arrêtaient sans raison sur une prise électrique, Félix Ferrer abandonna ses clefs sur la console de l’entrée. Puis il boutonna son manteau avant de sortir en refermant doucement la porte du pavillon.
Pour finir comme cela :
[...] Je suis désolé, dit Ferrer en s’approchant avec prudence, je n’avais pas du tout prévu ça. C’est un peu compliqué à expliquer. Pas grave, dit la fille, je suis moi-même là par hasard. Vous allez voir, il y a des gens assez marrants. Allez, venez. Bon, dit Ferrer, mais je ne reste qu’un instant, vraiment. Je prends juste un verre et je m’en vais.
Entre ces deux Je m'en vais, deux cent pages où il ne se passe pas grand chose, comme d'habitude chez Échenoz, juste l'errance de ce Ferrer, marchand d'art qui se prête quand même à un voyage au fin fond du Canada pour récupérer quelques babioles d'esquimaux, une fortune d'art ethnique qui ... bon, on ne va quand même pas vous raconter le fil ténu de l'intrigue presque policière qui agrémente le récit.
Mais comme d'usage chez cet auteur, ce n'est pas l'important : l'essentiel est ailleurs, dans les petits riens sans importance justement, les petits riens qui font le récit du réel, de la vraie vie des personnages dont Échenoz tire le portrait.
Car Jean Échenoz est grand portraitiste.
Le sieur Ferrer connaîtra quelques déboires avec sa galerie d'art mais aura surtout du mal à se fixer auprès de la gente féminine, entre deux Je m'en vais :
[...] Cette moitié féminine peut aussi, a-t-il remarqué, se diviser en deux populations : celles qui, juste après qu’on les quitte, et pas forcément pour toujours, se retournent quand on les regarde descendre l’escalier d’une bouche de métro, et celles qui, pour toujours ou pas, ne se retournent pas. En ce qui concerne Ferrer, il se retourne toujours les premières fois pour estimer à quelle catégorie, retournante ou non retournante, appartient cette nouvelle connaissance. Ensuite il procède comme elle, se plie à ses manières, calque son comportement sur le sien vu qu’il ne sert vraiment à rien de se retourner si l’autre pas.
Ah, quelle musique. Échenoz est incontestablement notre auteur français préféré, inégalé sans doute parmi ses contemporains.
Ce bouquin n'est peut-être pas le meilleur de la série mais ressemble un peu, avec ses faux airs de polar, au Lac déjà commenté ici.
(1) : oui, plutôt une cannette de bière qu'une bonne bouteille de vin : les bouquins d'Echenoz sont généralement courts et plutôt du format 33cl que 75cl, c'est comme ça.
Pour celles et ceux qui aiment les esquimaux.
Les éditions de minuit éditent ces 199 pages qui ont obtenu le Goncourt de 1999.
Une bio d'Échenoz et d'autres avis chez Babelio.

 Les îles aux trésors.
Les îles aux trésors. Lectures givrées.
Lectures givrées. L’avenir est derrière nous.
L’avenir est derrière nous.
 Cold case à la danoise.
Cold case à la danoise. [...] Pour commencer sa femme l'avait quitté. Ensuite, elle avait refusé de divorcer, tout en continuant à vivre séparé de lui dans son abri de jardin. Finalement, elle s'était offert une brochette d'amants beaucoup plus jeunes qu'elle et avait pris la mauvaise habitude de lui téléphoner pour les lui décrire. Ensuite, son fils avait refusé de continuer à vivre avec elle et s'était réinstallé chez Carl, en plein crise adolescente. Et pour finir, il y avait eu cette fusillade à Amager, qui avait stoppé net tout ce à quoi Carl s'était raccroché.
[...] Pour commencer sa femme l'avait quitté. Ensuite, elle avait refusé de divorcer, tout en continuant à vivre séparé de lui dans son abri de jardin. Finalement, elle s'était offert une brochette d'amants beaucoup plus jeunes qu'elle et avait pris la mauvaise habitude de lui téléphoner pour les lui décrire. Ensuite, son fils avait refusé de continuer à vivre avec elle et s'était réinstallé chez Carl, en plein crise adolescente. Et pour finir, il y avait eu cette fusillade à Amager, qui avait stoppé net tout ce à quoi Carl s'était raccroché. Black power.
Black power. Et le bouquin de leur fille,
Et le bouquin de leur fille,  Fait divers.
Fait divers. Un voisin encombrant.
Un voisin encombrant. Séparée de son ex, Yasuko vit seule avec sa fille. Jusqu'ici elle fait à peine attention à son voisin, Ishigami, un prof de maths.
Séparée de son ex, Yasuko vit seule avec sa fille. Jusqu'ici elle fait à peine attention à son voisin, Ishigami, un prof de maths.  Un J. E. Hoover suédois ?
Un J. E. Hoover suédois ? [...] Grâce à ses connaissances historiques et à ce qu'il savait sur les services étrangers de renseignements, Berg avait élaboré une stratégie quant à la façon de développer cette nouvelle activité. Son but ultime était un service secret, voire une organisation toute entière échappant à tout contrôle démocratique, qui surveillerait non seulement la DST elle-même mais aussi les activités dites officielles au sein de la police, de l'armée ainsi que de tout autre organisme ou groupe, public ou privé, dont les activités risquaient de mettre en danger le pouvoir politique.
[...] Grâce à ses connaissances historiques et à ce qu'il savait sur les services étrangers de renseignements, Berg avait élaboré une stratégie quant à la façon de développer cette nouvelle activité. Son but ultime était un service secret, voire une organisation toute entière échappant à tout contrôle démocratique, qui surveillerait non seulement la DST elle-même mais aussi les activités dites officielles au sein de la police, de l'armée ainsi que de tout autre organisme ou groupe, public ou privé, dont les activités risquaient de mettre en danger le pouvoir politique.  Apartheid.
Apartheid. L'Afrique du Sud à cette époque (on est à la toute fin des années 70, dans les dernières années de l'apartheid) est encore un pays où l'on ne condamne pas un blanc qui défend son bien (et même sa vie, Votre Honneur) contre d'affreux bantous(1). Alors le vieil épicier continue son manège, et c'est tout juste s'il doit se soumettre à quelques visites à notre psychologue de service.
L'Afrique du Sud à cette époque (on est à la toute fin des années 70, dans les dernières années de l'apartheid) est encore un pays où l'on ne condamne pas un blanc qui défend son bien (et même sa vie, Votre Honneur) contre d'affreux bantous(1). Alors le vieil épicier continue son manège, et c'est tout juste s'il doit se soumettre à quelques visites à notre psychologue de service. Tijuana blues.
Tijuana blues. Course poursuite.
Course poursuite. Néo-néo-colonialisme.
Néo-néo-colonialisme. C’est l’histoire d’une maison.
C’est l’histoire d’une maison. On se méfiait un peu des Actes Noirs d'Actes Sud depuis leur trop grand succès et leur trop célèbre saga.
On se méfiait un peu des Actes Noirs d'Actes Sud depuis leur trop grand succès et leur trop célèbre saga.  Exercice de style.
Exercice de style. Polar noir des années noires.
Polar noir des années noires. L’inspecteur Chen devient écolo ?
L’inspecteur Chen devient écolo ? Alice au pays des merveilles nipponnes.
Alice au pays des merveilles nipponnes. Polar sans crime.
Polar sans crime. Le pelleteux de nuages dans le bocage normand.
Le pelleteux de nuages dans le bocage normand.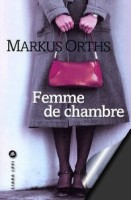 La solitude des chambres d’hôtel.
La solitude des chambres d’hôtel. Le chant glacé des sirènes.
Le chant glacé des sirènes. Parfum de rose islandaise.
Parfum de rose islandaise. Rattrapé par le passé.
Rattrapé par le passé.