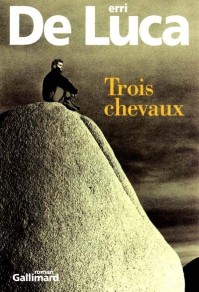 Dialogues avec un jardinier.
Dialogues avec un jardinier.
Après Trois mille chevaux vapeurs de Antonin Varenne, voici Trois chevaux !Mais en matière de lettres, on aurait tort de se fier aux seuls chiffres.
 D'abord parce qu'en dépit de la proximité des titres nous ne sommes pas du tout dans le même registre et ensuite parce qu'en dépit de son modeste attelage chevalin, ce roman de l'italien Erri de Luca est un bijou de grande qualité. Une poignée de perles serties avec soin dans un beau collier de prose.
D'abord parce qu'en dépit de la proximité des titres nous ne sommes pas du tout dans le même registre et ensuite parce qu'en dépit de son modeste attelage chevalin, ce roman de l'italien Erri de Luca est un bijou de grande qualité. Une poignée de perles serties avec soin dans un beau collier de prose.De poésie même, devrait-on dire tant est belle la plume du napolitain.
Une plume avec laquelle il peint les choses ordinaires ou mieux, ce que laissent deviner les choses ordinaires.
Comme la simple pause déjeuner au café du coin ...
[...] Je mets la soupe entre moi et le livre posé contre le demi-litre. [...] Je mange. La cuillère est amie de la lecture, elle pêche même toute seule dans l'assiette. La fourchette demande plus d'attention.Quelques moments de la vie d'un homme simple (appelé d'ailleurs L'homme par un ami).
Et pour une fois, un homme simple qui n'est pas décrit par un parisien.
Un jardinier.
Un ancien émigré parti en Argentine et qui est revenu de la dictature un peu meurtri forcément. Erri de Luca a toujours été engagé politiquement.
Dans ce petit livre, l'auteur évoquera également les Balkans (qu'il a connus), en quelques mots terribles.
[...] Tout autour les champs sont immobiles, les mines attendent les pas. Comment grandissent les enfants avec tant de terre interdite autour d'eux ? [...]En dépit de ce décor géopolitique un peu sombre, l'histoire est lumineuse. Celle d'un homme ordinaire, simple jardinier. Evidemment on ne peut que songer à la sage maxime chinoise qui veut que :
Il répond que les femmes attachent les enfants quand elles doivent sortir et les laisser seuls.
Cultiver son jardin et ses légumes pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce qu'on appelle la politique des simples.
Un être simple mais entier et humain, dont on ne saura même pas le nom mais dont on apprendra tant de choses.
Et qui nous fera faire quelques belles rencontres. Un ami ou deux, un africain ou deux.
[…] Selim vient au jardin pour le mimosa et pour parler un peu de son pays où l'on va pieds nus et c'est pour ça qu'on parle volontiers. Quand on met des souliers on ne parle pas, c'est ce qu'il pense de nous. Sans la plante des pieds nue sur le sol, nous sommes isolés.Et quelques femmes. De très beaux et respectueux portraits de femmes.
[…] J'ai plus de vie passée à regarder la terre, l'eau, les nuages, les murs, les outils, que les visages. Et je les aime. À présent, j'erre sur celui de Làila, ses pommettes astiquées comme des cuivres, une bouderie des lèvres, détails mal assortis. Quand j'y pense, je n'arrive pas à retenir un visage de femme tout entier.La prose (ou la poésie) de Erri de Luca n'est pas vraiment épurée. Au contraire, chaque mot est choisi, chaque phrase est ciselée (longuement sans doute) parfois jusqu'à l'excès.
[…] Devant une femme, je sens le Napolitain qui a envie de la faire rire. Sans éclats de rire avant, les baisers sont fades. Je ne le lui dis pas.
[…] Des histoires de femmes hindoues qui, lorsque se lève un vent de tempête, sortent les seins nus pour l'arrêter.
Ce travail d'orfèvre nous vaut quelques perles scintillantes. De la magie pure qui nous laisse pantois.
[…] Ce n'est qu'au printemps que je taille les lauriers, quand ils ne servent plus d'abri aux moineaux. J'aime brûler les restes de leur feuillage. Ils font une fumée qui étourdit et fait revenir en mémoire les disparus.Mais parfois aussi, l'artisan nous livre quelques pièces trop ouvragées qui déparent la vitrine. Ce sont les risques du métier et l'orfèvre Erri de Luca n'hésite pas à prendre quelques risques.
[…] Ces jours-là, je vois clair dans la géométrie. Les vivants ne sont pas à la perpendiculaire des morts étendus, ils leur sont parallèles. La faux n'a pas la courbe de la lune, mais celle de l'œuf.On pense à d'autres plumes plus légères : Maxence Fermine (un savoyard), Alessandro Baricco (encore un italien). Et John Fante même parfois (encore un autre).
Ce petit roman aurait gagné à être un peu allégé tant finissent par peser les effets de sieur Luca. Mais ne boudons pas le plaisir de goûter à de la belle ouvrage venue du sud italien. On tient là une belle histoire d'amour.
Et ces trois chevaux alors ?
[…] Une vie d'homme dure autant que celle de trois chevaux et tu as déjà enterré le premier.
Pour celles et ceux qui aiment les arbres et les fleurs.
D'autres avis sur Babelio.

 Et c'est l'histoire de ces deux femmes, l'Histoire de ces vallées et de ces années, que nous raconte Francesca Melandri, alternant avec équilibre et précision les chapitres, le présent de la moderne Vera et le passé de la savoureuse Gerda.
Et c'est l'histoire de ces deux femmes, l'Histoire de ces vallées et de ces années, que nous raconte Francesca Melandri, alternant avec équilibre et précision les chapitres, le présent de la moderne Vera et le passé de la savoureuse Gerda. 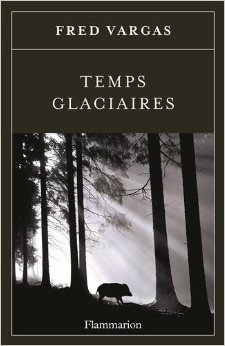
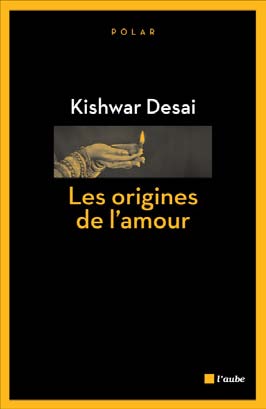
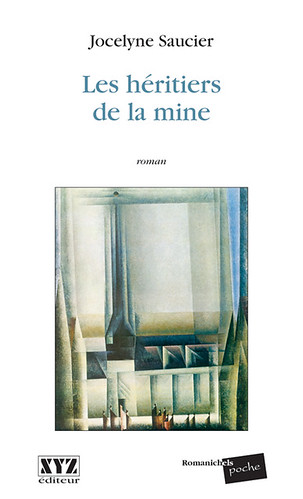
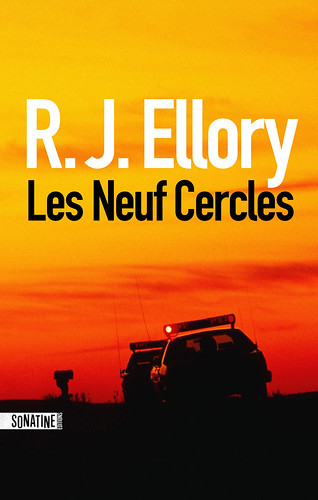 On dirait le Sud …
On dirait le Sud …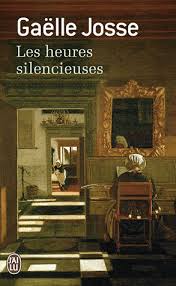
 La peinture flamande est réputée pour la lumière qu'elle laisse tomber sur les visages : Gaëlle Josse a choisit peut-être le seul tableau de cette époque qui présente une femme de dos et elle réussit à lui redonner vie et visage !
La peinture flamande est réputée pour la lumière qu'elle laisse tomber sur les visages : Gaëlle Josse a choisit peut-être le seul tableau de cette époque qui présente une femme de dos et elle réussit à lui redonner vie et visage !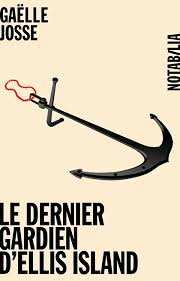


 […] Szacki n’en croyait pas ses oreilles. « C’est de la connerie en barre. Le mensonge le plus débile que j’ai entendu au cours de ma carrière. »
[…] Szacki n’en croyait pas ses oreilles. « C’est de la connerie en barre. Le mensonge le plus débile que j’ai entendu au cours de ma carrière. »