Taphéphobie et hypothermie.
Ah, quel beau cadeau de fin d’année que cet Indridason qui coule de la meilleure veine, celle où le commissaire Erlendur est au sommet de sa forme.Depuis plusieurs épisodes, on savait le policier islandais en vacances prolongées et les enquêtes étaient désormais conduites par ses acolytes (Sigurdur Oli et Elinborg). On avait d’ailleurs laissé tomber la série qui avait perdu beaucoup de son intérêt.
Mais voilà donc le retour inespéré du commissaire tourmenté … dans ce qui ressemble fort à une dernière enquête en forme de testament.
Erlendur n’aura jamais été aussi proche de ce qui le tourmente depuis l’enfance et la disparition de son frère cadet. On découvrira d’ailleurs avec ces Étranges rivages, plusieurs clés des cauchemars du commissaire, de sa culpabilité latente et de ses motivations à sonder sans cesse les mystères des disparitions inexpliquées .
On tient là (outre ce qui semble donc bien être la dernière apparition d’Erlendur) l’un des meilleurs bouquins d’Arnaldur Indridason.
L’auteur y abandonne presque le côté polar pour se consacrer exclusivement aux mystérieuses “disparitions” islandaises que nous connaissons maintenant presque aussi bien que notre cher Erlendur.
Le commissaire est en ‘vacances’ dans les fjords de l’est et il n’y a quasiment pas d’enquête au sens policier du terme : les faits évoqués remontent bien loin, aussi loin que la disparition du petit frère d’Erlendur et il y a prescription depuis belle lurette.
[…] - Je travaille dans la police.Erlendur profite de ses vacances sur les lieux de son enfance pour tenter de renouer le fil de ses souvenirs, ceux qui le hantent de puis la disparition de son jeune frère.
– Vous ne devez pas beaucoup vous amuser.
– Non. Souvent, ce n’est pas drôle.
[…] Boas s’était immobilisé et avait regardé Erlendur.
– Qu’est-ce que vous me disiez que vous faites dans la police ?
– Je dirige des enquêtes.
– De quel genre ?
– De différentes natures, grand banditisme, meurtres, crimes violents.
– Toute la lie de l’humanité ?
– On peut le dire.
– Et les disparitions ?
– Oui, aussi.
[…] Erlendur ne s’était pas présenté, mais il le fit à ce moment-là, il expliqua qu’il venait de Reykjavik, mais qu’il était né dans les fjords de l’est et qu’il s’intéressait aux histoires de gens qui s’étaient perdus dans les montagnes, de gens dont les corps n’avaient jamais été retrouvés et dont personne ne connaissait le destin avec certitude.
[…] Erlendur défendait depuis longtemps une théorie selon laquelle, parmi toutes ces disparitions, aussi diverses soient-elles, se cachaient sans doute quelques meurtres ici et là.
Au fil de ses recherches, il croise ses propres fantômes mais également les mystères d’une autre disparition, celle de Matthildur.
Le commissaire en vacances, pose donc ses questions de ci de là, persévérant et obstiné, s’attachant à exhumer les vérités d’un lointain passé, enfouies sous la glace ou la terre. Ce qui nous vaut de beaux portraits et de savoureux dialogues.
[…] - Quelqu’un m’a raconté que vous étiez policier à Reykjavik. C’est pour cette raison que vous venez m’interroger sur Matthildur ?Alors oui on s’intéresse bien sûr aux raisons de la disparition de Matthildur que l’on devine peu à peu : tout cela nous est raconté comme un presque polar. Mais ce qui fait la réelle saveur de ce bouquin, c’est bien sûr le récit des questionnements d’Erlendur, ses échanges et ses dialogues avec les islandais qu’il croise, ce que chacun apporte peu à peu au récit et les clés des mystères qui nous sont délivrées peu à peu : le mystère de la disparition de Matthildur et le mystère de la disparition de Beggur, le petit frère d’Erlendur. Elles n’ont rien en commun ces disparitions : sauf d’être des disparitions islandaises comme seul Arnaldur Indridason sait nous en raconter.
– Non, répondit Erlendur, plutôt par curiosité personnelle. Je m’intéresse à ce genre d’histoires.
[…] Kjartan le regarda de ses yeux fatigués, il n’était pas certain de comprendre où Erlendur voulait en venir.
– Je suis policier à Reykjavik et je suis en vacances ici, dans les fjords de l’est. Le hasard veut que je sois originaire de la région et que j’aie entendu parler de Matthildur lorsque j’étais encore gamin. Son histoire a piqué ma curiosité. Mon but n’est pas de dévoiler quoi que ce soit ou de démasquer quiconque. Ce que je fais là n’a rien à voir avec une enquête de police.
[…] – Vous m’avez dit que vous étiez policier, observa Hrund au bout d’un long moment.
– En effet.
– J’ai toujours pensé que… Elle inspira profondément, éreintée.
– Que… ?
– J’ai toujours pensé que… la disparition de Matthildur aurait mérité qu’on ouvre une enquête.
[…] – Vous avez découvert de nouveaux éléments concernant Matthildur ? interrogea-t-il sans ambages, comme si Erlendur avait ouvert une enquête sur cette disparition datant de plus de soixante ans.
– Non, aucun, répondit-il en s’allumant une cigarette afin d’accompagner Boas. D’ailleurs, comment pourrait-il y avoir du neuf ? Elle a péri dans cette tempête. On en a vu d’autres.
– Ah, j’en ai bien peur, convint Boas en avalant son café coloré au lait. Oui, on en a vu d’autres.
Si Erlendur ne semble passionné que par les morts et les disparus, Indridason lui s’intéresse bien aux vivants, meurtriers ou victimes, qui portent sur leurs trop frêles épaules le poids de ces fantômes.
Indiscutablement, cet auteur vient là de couronner brillamment son œuvre.
Toute bonne série a (malheureusement) une fin et celle-ci est particulièrement réussie.
Alors en guise de conclusion et d’hommage à toutes nos lectures Indridasoniennes, on retiendra cette citation :
[…] Il avait en mémoire d’autres enquêtes sur lesquelles il avait travaillé et qui, chacune à sa manière, l’avaient marqué. Elles étaient nombreuses et de nature diverse, mais aucune d’entre elles ne l’avait conduit à pénétrer dans un cimetière à la faveur de la nuit, une bêche à la main.Si vous ne connaissiez pas encore (mais est-ce vraiment possible ?), on ne saurait trop vous conseiller de commencer par les autres ouvrages avant d’arriver vous aussi à cette belle conclusion.
Pour celles et ceux qui aiment les mystères des disparitions islandaises.
D’autres avis sur Babelio.
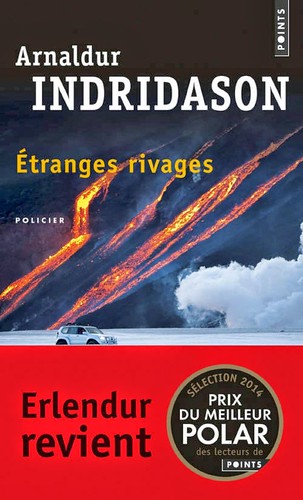



 Le sujet était pour le moins intrigant :
Le sujet était pour le moins intrigant : 




