Aye, soldados desgraciados.

Ce bouquin de Rick Bass, La décimation, est une petite leçon sur l'histoire du Texas : le deuxième plus grand état de la fédération (après l'Alaska) et le deuxième plus peuplé (après la Californie). Un état dont la superficie dépasse celle de la France.
Autant dire un des piliers de ces Etats-Unis.
Autant dire que son histoire particulière éclaire celle plus générale de l'ensemble de la fédération.
Après être resté longtemps une colonie espagnole, il fut intégré au Mexique nouvellement indépendant. Pendant quelques années (vers 1840), Samuel Houston proclama le Texas comme nation indépendante avant d'accepter le rattachement aux Etats-Unis (lone star) dont la protection permettait de garder les mexicains au-delà du Rio Grande. Cette région connut donc près d'un demi-siècle de guerres, contre les Comanches, puis les Mexicains, puis même contre les Etats abolitionnistes du nord.
[...] Nous nous trouvions de notre côté de la frontière, entre Texans, car l’on ne pouvait pas encore vraiment parler d’Américains : nous étions toujours une nation séparée.
Rick Bass prend prétexte d'un épisode réel de 1842 : une milice texane, à demi encouragée par le gouvernement de Sam Houston (quand tout va bien), à demi désavouée (quand ça tourne mal), une milice de volontaires et de patriotes, une bande d'irréguliers franchit la frontière contestée et commet une série d'exactions et de pillages avant d'être vaincue par l'armée mexicaine.
[...] Le président du Texas, Sam Houston, [...] disait qu’il n’y avait malheureusement pas de budget pour armer les milices ou les groupes de patriotes comme le nôtre. « Le gouvernement ne promettra rien d’autre que la légitimité de l’expédition et il fournira les munitions nécessaires à la campagne. Les volontaires devront donc se tourner vers la vallée du Rio Grande pour une quelconque rémunération », ainsi s’était-il exprimé devant les journalistes, et il est probable qu’il pensait à l’autre rive – le côté mexicain.
[...] Il annonça à la presse : « Notre gouvernement promet de ne rien réclamer sur les prises de guerre, elles seront partagées entre les vainqueurs. » Il conclut par une notification : « Le drapeau du Texas accompagnera toutes les expéditions de ce genre. »
Des quelques centaines de prisonniers, très peu survivront.
Ce roman nous conte cette épopée sanglante et malheureuse par les yeux d'un tout jeune volontaire, James Alexander.
Il partit vaillant, aventureux et téméraire, avide de rattraper le temps perdu (il avait manqué les batailles glorieuses de Fort Alamo et San Jacinto).
Il eut la chance de revenir vieilli, affamé, blessé, pouilleux, épuisé, malade. Pour témoigner, sous la plume de Rick Bass, de cette longue descente aux enfers.
L'équipée du jeune Alexander et de ses compagnons est là pour nous rappeler la bêtise insondable de la guerre et la noirceur de la vanité humaine. Il s'agit bien d'un rappel et d'une leçon : Rick Bass écrivait son bouquin en 2003 pendant que l'armée américaine (qui devait toujours compter pas mal de texans dans ces rangs ?) envahissait l'Irak.
Le personnage de James Alexander est trop velléitaire pour que l'on prenne fait et cause pour lui et l'on s'intéresse plus à ses compagnons qu'à lui-même (mais c'est certainement voulu ainsi).
Quant à l'écriture un peu à l'ancienne (façon roman d'aventures américains du siècle dernier), elle manque un peu de précision et de personnalité pour que l'on puisse parler d'un excellent roman.
Mais, on l'a dit, le contexte est passionnant et on a plaisir à découvrir cette leçon d'Histoire sous la plume habituellement écolo de Rick Bass.
Pour celles et ceux qui aiment les deux rives du Rio Grande.
D'autre avis sur Babelio.
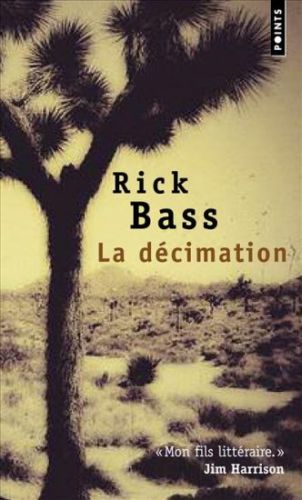
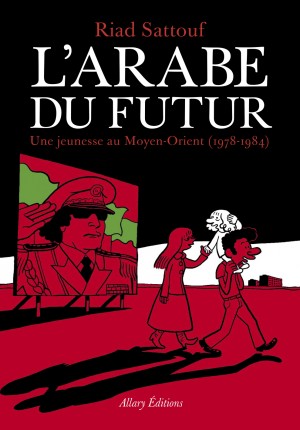

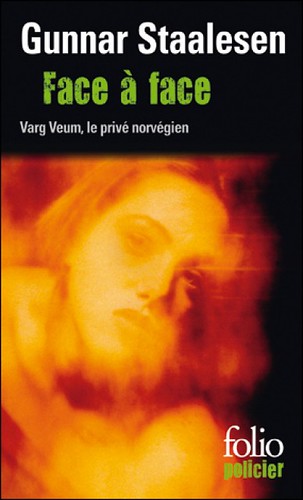


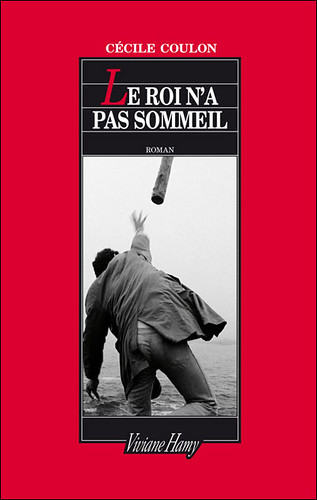


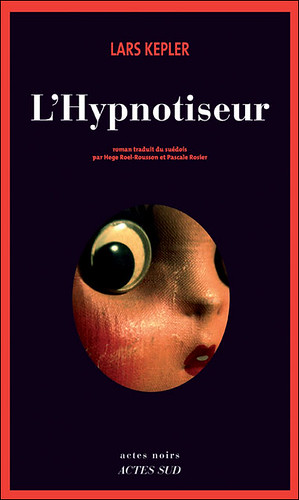
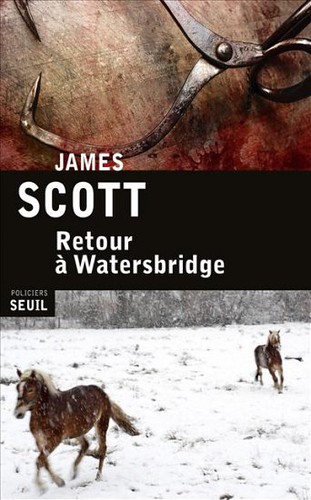 Western glacé.
Western glacé. 