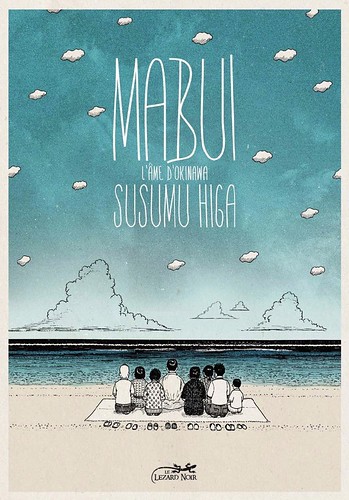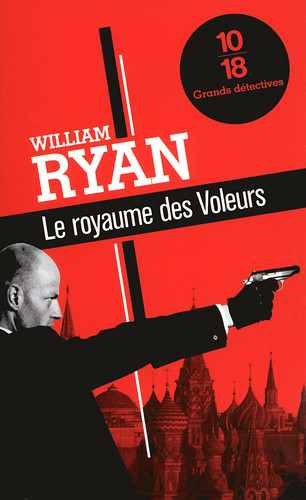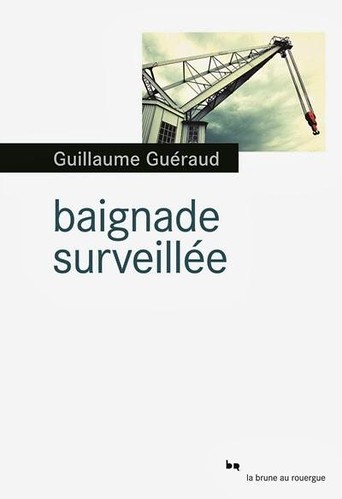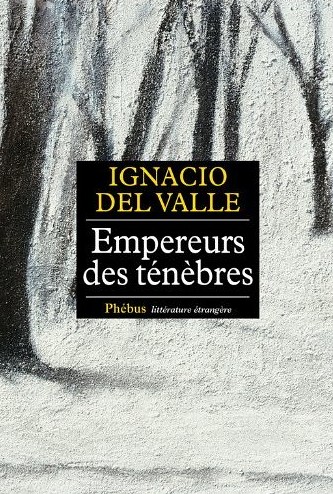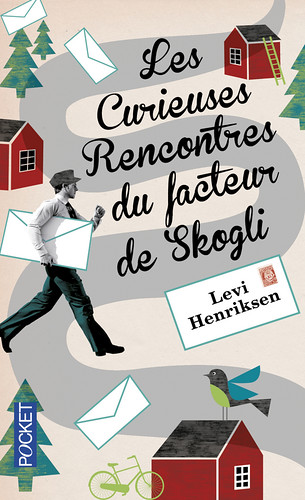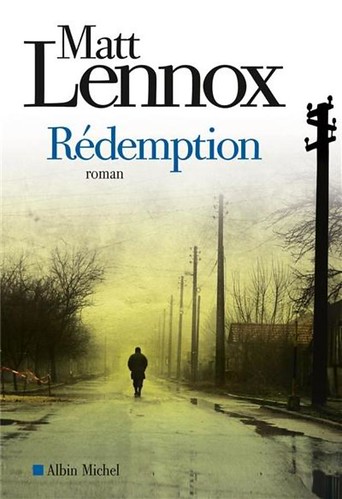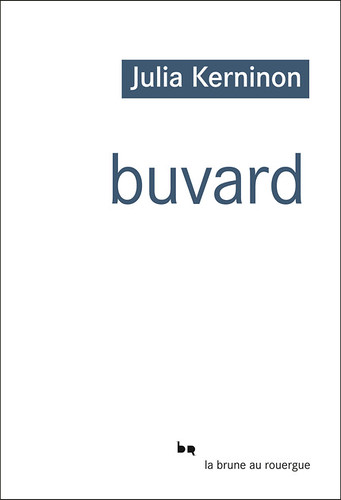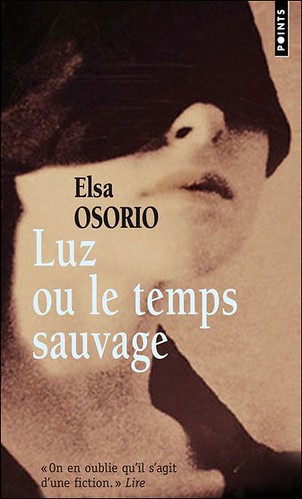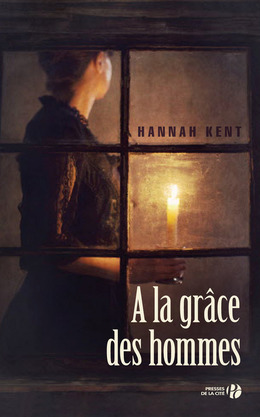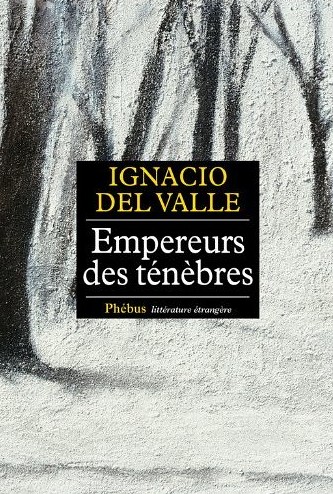
Quand les dieux détournent les yeux …
 Empereurs des ténèbres
Empereurs des ténèbres de l'espagnol
Ignacio del Valle, est la deuxième
(1) enquête du soldat
Arturo Andrade, après
L'art de tuer les dragons [pas traduit en français] et avant
Les démons de Berlin [pas encore lu] .

Effet de mode, intérêt cyclique ou fascination étrange pour les démons de cette période ?
Philip Kerr et son inspecteur Bernie nous promenaient dans les bunkers nazis tandis que
Maurizio di Giovanni et son étrange commissaire Ricciardi nous faisaient défiler les quatre saisons sous l'Italie de Mussolini.
Il manquait donc un chaînon : et c'est Del Valle qui se charge de nous emmener voir du côté des franquistes.
Mais pour cet épisode, habillez-vous chaudement : on ne part pas pour Madrid et on accompagne la division Azul sur le front de l'Est en plein hiver 1943.
La division Azul on l'avait déjà croisée avec
La tristesse du Samouraï. Ce sont ces phalangistes envoyés par Franco soutenir la Wehrmacht
(2) et affronter le général Hiver sur le front de l'est lors de l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie qui se transformera bientôt en déroute napoléonienne. Nous voici donc près de Leningrad pendant l'hiver 43, près d'un monastère orthodoxe
(3).
[...] Les coupoles irisées du monastère orthodoxe de Molevo. Selon la légende, une nuit, un moine qui faisait une ronde y avait rencontré Dieu assis dans un recoin obscur ; que faisait son Seigneur en un tel endroit ? s’était écrié le moine en se prosternant immédiatement devant lui. Dieu lui avait répondu, d’une voix non pas tonitruante, mais éteinte : « Je suis fatigué, pope, très fatigué. »
Et ça commence fort justement par une image toute napoléonienne (ou digne de Guernica, ça marche aussi), avec une cavalcade de chevaux saisie dans la glace. Au milieu un soldat. Évidemment gelé mais égorgé aussi, c'est moins évident et, là c'est de moins en moins évident, avec une inscription gravée soigneusement au couteau sur la poitrine :
Prends garde, Dieu te regarde.
[...] - Pour faire ça, il faut un individu qui ne manque pas de sang-froid.
- Ailleurs, je ne sais pas, mais ici, c’est comme si vous me parliez de n’importe qui.
Et donc même si on pourrait objecter que :
[...] Ici les vivants ne comptent plus , alors les morts...vous imaginez ...
Ce cadavre pris dans les glaces, ça fait quand même désordre et le soldat Arturo Andrade est donc chargé de mener rondement l’enquête, histoire de restaurer le moral des troupes et un semblant de discipline. Et il se demande où il met les bottes : au sein de l’État-major les rivalités sont grandes entre phalangistes romantiques et militaires franquistes purs et durs, entre francs-maçons et fascistes pas francs du collier, tous réunis par la force des choses sous la bannière du Caudillo
(4). Et maintenant sous celle de la Wehrmacht qui scrute tous ces espagnols débraillés d'un œil comment dire, bienveillant ? oui, c'est cela : bienveillant.
[...] Pourquoi se soucier d’un mort quand des millions d’hommes sont en train de se massacrer ?
[...] Le suspect parfait n’existe que dans les romans, à l’inverse du crime parfait qui n’est possible que dans la réalité.
Arturo va donc enquêter sur ce crime mystérieux pendant que les russkofs pilonnent les positions et tandis que les généraux de tous bords s'impatientent. Et comme il fait moins 30° dehors, autant dire que c'est cool.
[...] Il était conscient de ne pas avoir été aussi heureux depuis des temps presque immémoriaux ; son caractère obsessionnel qui le faisait tant souffrir, temporairement neutralisé par les exigences monolithiques de l’armée, trouvait un succédané dans ce travail et lui permettait de s’y consacrer avec la persévérance d’un martyr.
Et ça se complique encore quand on découvre que la victime était devenue adepte de la violeta.
[...] Cette terrible variante de la roulette russe, où on remplissait progressivement les chambres jusqu’à n’en laisser qu’une seule vide, s’appelait la violeta, parce que, comme les invertis ou violetas, si les joueurs voyaient un trou, c’était pour le boucher.
Voilà pour l'ambiance : riche et passionnante, violente et dure, inhumaine et surtout glacée.
[...] Ce n’était pas une morgue classique mais simplement une pièce dont le poêle n’était jamais allumé.
Ensuite, il y a le style. Celui de Del Valle est parfaitement adapté à l'ambiance : pas de sentiment inutile ni d'empathie superflue. On ne voit pas trop comment on arrive à s'intéresser au soldat Arturo qui n'a même pas la gouaille cynique du susnommé Bernie : l'ami Arturo a quand même donné dans les renseignements franquistes et son passé n'a rien à envier à celui de ses collègues, franquistes, phalangistes, SS, que du beau monde aux environs de Leningrad.
Mais ça marche. Peut-être parce qu'on est sur le front de l'est, c'est-à-dire en enfer et qu'en enfer peu importe d'où vous venez.
Les dialogues sont riches, doubles ou triples, et se révèlent souvent des affrontements durs, cyniques, violents : chacun épie l'autre et cherche à deviner le coup suivant. Le lecteur, lui, se régale d’une langue riche et recherchée.
De temps à autre, on regrette une envolée un peu trop lyrique, au style un peu ampoulé : pendant quelques lignes, Del Valle se laisse emporter par le souffle romantico-mystique de l’Histoire, mais ça ne dure pas.
Sur le front de l’est, le siècle a basculé, le monde est en train de se désagréger : meurtres en série, folie dégénérée, sexe déréglé, hécatombes militaires, même les dieux détournent les yeux.
Et c’est Jack l’Éventreur qui est mis en exergue.
[...] S’il ne s’est pas fait piéger, c’est qu’il a tué sans mobile ; impitoyablement, mais sans raison. Il tuait pour le plaisir de tuer, il aimait ça. Il suivait son instinct, qui n’est pas différent de celui de n’importe lequel d’entre nous. Quand l’Éventreur a utilisé son couteau pour la première fois… Il a inauguré le XXe siècle, un siècle qu’il a baptisé dans le sang, improvisa mentalement Arturo.
Brrrrr …
Rien de bien gai dans cette fin de monde mais l’intrigue policière est plus subtile qu’il n’y parait et le décor historique passionnant.
(1) - aucun souci pour lire ce deuxième épisode sans avoir connaissance du premier : quelques références y sont faites bien sûr mais qui ne sont nullement gênantes et qui ajoutent même un peu d'épaisseur mystérieuse au personnage d'Arturo Andrade
(2) - Franco était partagé entre la nécessité de soutenir le camarade Hitler encore tout puissant et la pression de ses voisins : la division Azul fut donc un contingent ... de volontaires (près de 20.000 hommes quand même), ce qui ménageait et la susceptibilité des Alliés, et les besoins de renfort pour la Wehrmacht en remerciement de l'aide apportée pendant la guerre civile.
(3) - on pense aussi au Rouge-gorge de Jo Nesbo dont une partie se déroulait également sur le front de l’est pendant le siège de Leningrad
(4) - vous ferez comme nous et apprendrez, grâce à Del Valle clair et didactique mais jamais pesant ni pédant, quelles étaient les clivages entre tous ces salopards
D'autres avis sur Babelio.