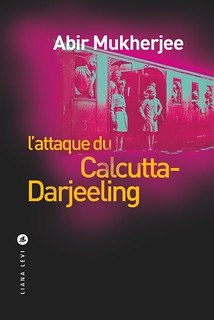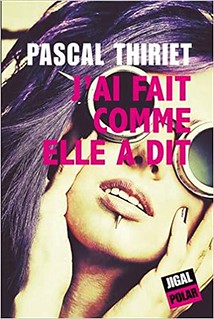[...] J’avais passé moins de cinq minutes sur le toit du monde.

[...] En mars 1996, le magazine Outside m’envoya au Népal pour participer à une ascension de l’Everest et en faire le récit.
En 1852, Sikhdar , un arpenteur indien au service de la couronne britannique mesure pour la première fois la hauteur du nouveau toit du monde.
[...] L’explorateur américain Robert Peary avait annoncé qu’il avait atteint le pôle Nord en 1909. Roald Amundsen avait mené une expédition norvégienne au pôle Sud en 1911. L’Everest, le « troisième pôle », devenait l’objectif le plus convoité des explorateurs terrestres.
Les premiers au sommet furent en 1953, Edmund Hillary et le sherpa Tensing Norgay :
[...] Cent un ans s’écoulèrent après la découverte de Sikhdar avant que le sommet soit finalement atteint. Quinze expéditions s’étaient succédé et vingt-quatre hommes avaient perdu la vie.
En 1996, les expéditions "commerciales" sont devenues monnaie courante (mauvais jeu de mots) et l'on peut se faire amener à l'altitude de croisière des avions pour environ 65.000 dollars (et deux mois de congés).
Au printemps 1996 il y avait quatorze cordées et plus de 300 tentes au camp de base à 5.300 mètres.
Jon Krakauer accompagne l'une de ces cordées.
On connait désormais l'issue de la tragédie que l'on a pu voir au cinéma en 2015 dans le film de l'islandais Baltasar Kormakur : 8 morts ce jour-là perdus en plein blizzard et tempête de neige à 8000 mètres. La saison fut l'une des plus meurtrières (sans compter les amputations de doigts ou de nez).
Jusqu'où peut aller la folie des hommes ?
Krakauer nous en donne un assez bon aperçu, même s'il se perd un peu parfois (mais jamais trop longtemps) dans les justifications et explications pas très utiles rétrospectivement : qu'est-ce qui a foiré ? qui a merdé ? etc ...
Il souffre un peu du complexe du survivant, on le comprend.
[...] Au printemps 1996, l’Everest tua en tout douze hommes et femmes. Ce fut la pire saison depuis que des alpinistes vont sur cette montagne, c’est-à-dire depuis soixante-quinze ans.[...] Une tragédie de cette importance était prévisible étant donné le nombre d’alpinistes si peu qualifiés qui se rendent en foule sur l’Everest de nos jours.[...] Entre 1921 et mai 1996, 144 personnes sont mortes pour 630 ascensions réussies, soit une sur quatre.
Et puis là-haut on est bien loin de la solidarité entre sportifs, que ce soit entre les cordées concurrentes ou même au sein d'une même équipe : des pieds à la tête, le corps va si mal que c'est plutôt chacun pour soi.
Et que dire de la satisfaction de ceux qui arrivent au sommet ?
Le froid, la soif, l'épuisement, les engelures, la faim, la fatigue, le sommeil, le manque d'oxygène, ... les zombies prennent une photo rapide et hagards, entament la redescente au plus vite.
Trop tard pour certains qui n'arriveront pas au camp.
[...] Dans ces conditions, je sentais que j’avais froid, que j’étais fatigué, et rien d’autre.[...] J’avais passé moins de cinq minutes sur le toit du monde.
❤️ Paradoxalement, le récit est à la fois une triste peinture de cette folie meurtrière et un formidable roman d'aventures hors du commun.
Pour celles et ceux qui aiment la montagne, même en colère.
D’autres avis sur Babelio.

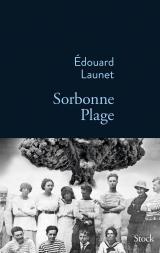










 Un écrivain français jusqu’ici inconnu de nos services :
Un écrivain français jusqu’ici inconnu de nos services :  Une sorte de double de Marc Charuel lui-même, parti à la chasse aux souvenirs indochinois.
Une sorte de double de Marc Charuel lui-même, parti à la chasse aux souvenirs indochinois.