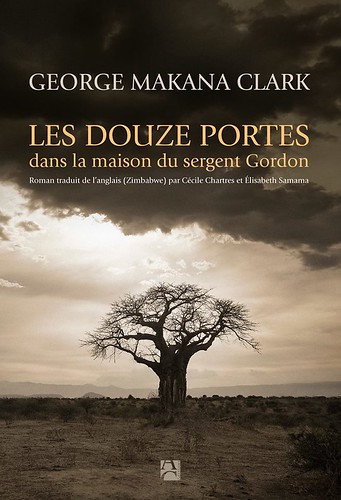[...] Elle me dit : « J’ai besoin de tuer quelqu’un. ».
L'auteur, le livre (208 pages, 2015) :
Ne manquez pas Boris Quercia, c'est très clairement la révélation polar de cette année 2015.
Saluons au passage les éditions Asphalte pour la découverte de cet auteur, les titres à double sens et le prix modique d'une édition électronique de qualité, à bon entendeur ...
Saluons au passage les éditions Asphalte pour la découverte de cet auteur, les titres à double sens et le prix modique d'une édition électronique de qualité, à bon entendeur ...
Avant Tant de chiens, c'est en début d'année que l'on avait découvert Les rues de Santiago (sans qu'on sache tout à fait s'il s'agissait de celles de la ville ou de celles arpentées par le héros homonyme) et l'on avait voulu attendre un peu avant d'épingler un coup de cœur au revers du veston de Quercia.
Pas obligatoire de lire dans l'ordre, mais ce serait dommage de laisser passer quelques pages (les bouquins sont pas épais) et le second est encore plus meilleur que le premier.
On aime :
❤️ Des chapitres courts, comme autant de petites nouvelles, avec un sens consommé de la chute, le petit truc anodin, sans rapport avec l'essentiel du récit, le petit truc qui vous grave au burin la scène en mémoire.
❤️ Un flic comme on les aime : ténébreux et solitaire, dur et maladroit en amours comme en affaires, Santiago Quiñones, un flic qui boit pas mal (sans surprise) et qui même ne dédaigne pas une ligne de coke de temps à autre. En suivant les traces de Quiñones dans les rues de Santiago, on s’intéresse plus au personnage et à ceux qu’il va croiser au gré de ses déambulations, qu'au fil de l'intrigue.
[...] C’est un grand type chauve, un peu voûté, comme souvent chez les gens grands au Chili. C’est un pays qui punit ceux qui dépassent la moyenne, les grands essayent de passer inaperçus et les très grands, comme ce type, se voûtent pour entrer dans le rang.
L'intrigue :
Il y a un problème avec les bouquins de Boris Quercia.
Un sacré problème : ses bouquins sont plutôt petits, pas très épais.
Dès les premières pages, alors qu'on a déjà surligné de nombreux passages pour citer dans ce blog, l'angoisse monte et on se prend à ne plus regarder les numéros de pages ou le compteur de la liseuse, on sait que le plaisir de la lecture ne durera qu'un temps que d'avance, on sait déjà trop court.
D'un autre côté (on se console comme on peut) on se dit que cette brièveté fait corps avec le style de Quercia, n'est-ce pas ?
Des petites phrases courtes, sèches, shootées à l'humanité, filmées à hauteur d'homme.
Et puis il en rajoute, le bougre ...
Un sacré problème : ses bouquins sont plutôt petits, pas très épais.
Dès les premières pages, alors qu'on a déjà surligné de nombreux passages pour citer dans ce blog, l'angoisse monte et on se prend à ne plus regarder les numéros de pages ou le compteur de la liseuse, on sait que le plaisir de la lecture ne durera qu'un temps que d'avance, on sait déjà trop court.
D'un autre côté (on se console comme on peut) on se dit que cette brièveté fait corps avec le style de Quercia, n'est-ce pas ?
Des petites phrases courtes, sèches, shootées à l'humanité, filmées à hauteur d'homme.
[...] Je cherche mes cigarettes et lui en offre une. Il ne fume pas, c’est ce genre-là.On vendrait ses gosses pour pouvoir écrire une phrase comme celle-ci.
Et puis il en rajoute, le bougre ...
[...] J’aime bien les gens qui savent allumer leurs allumettes malgré le vent et qui font cette espèce de petite maison avec leurs mains autour de la flamme. C’est plutôt mon genre, je me dis.Avant que l'intrigue policière ne vienne prendre le dessus, on pense (et il n'est peut-être pas de plus beau compliment ici) on pense souvent à John Fante, un Fante où la noirceur chilienne aurait occulté la luminosité italienne.
Tous les ingrédients sont encore et toujours là, tous ceux de la recette classique du polar noir, hardboiled comme dit désormais chez nous.
On peut donc reprendre le billet précédent presque mot à mot : embrouilles tordues, balles perdues mais pas pour tout le monde, collègues flics pas très cleans, femme(s) fatale(s) (bon, cette fois on a mis un 's') ...
Et puis il y a ces femmes fatales : au rayon polar c'est bien entendu plus souvent pour le pire que pour le meilleur et l'on sait désormais que Santiago ne se donne même pas la peine de faire semblant de résister à leurs charmes.
Et puis il y a ces femmes fatales : au rayon polar c'est bien entendu plus souvent pour le pire que pour le meilleur et l'on sait désormais que Santiago ne se donne même pas la peine de faire semblant de résister à leurs charmes.
[...] Comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, elle me dit : « J’ai besoin de
tuer quelqu’un. »
Et qui dit femmes, ... voici les polars les plus sexys depuis longtemps où pour une fois, les
scènes les plus chaudes ne semblent pas ‘téléphonées’ et écrites pour
racoler le gogo mais bien au contraire, elles s’intègrent parfaitement à
l’ambiance et au(x) personnage(s).
Et comme il semble être d'usage chez cet auteur, ça commence très fort avec une fusillade qui coûtera la vie à l'un de ses collègues, trop curieux ou trop ripoux, on ne sait pas encore.
[...] Ce n’était pas une situation facile, j’avais la maîtresse du mort au téléphone et sa veuve assise en face de moi.L'intrigue de ce second épisode est solidement construite autour d'un sujet difficile et pas cool : Tant de chiens à Santiago et Quercia n'écrit pas des guides touristiques pour nous vanter les mérites chiliens et nous parle plutôt de ceux qui vivent sur le rebord glissant du broyeur à viande.
[...] Tire-toi », je lui demande. Mais elle, loin de m’obéir, dégrafe sa robe et reste en face de moi, en petite culotte et talons hauts. « C’est gratuit », elle me dit, mais la vie m’a appris que rien n’est gratuit, et ça encore moins.
Et comme il semble être d'usage chez cet auteur, ça commence très fort avec une fusillade qui coûtera la vie à l'un de ses collègues, trop curieux ou trop ripoux, on ne sait pas encore.
[...] Les enterrements, c’est pas mon truc. Je continue à regarder le cercueil, m’attendant à tout moment à voir Jiménez se lever et nous dire que c’était une blague. Il avait son sens de l’humour, mon collègue, il m’a fait le coup une fois à la morgue. Il s’était couché sur une des civières, recouvert d’un drap, vous imaginez la suite… Mais de cette farce-là, il n’en sortira pas. C’est la blague finale, le clou du spectacle, et ce n’est pas drôle. Je ne supporte plus la messe.
[...] Moi, je pense que c’est juste un coup de bol. Mourir, pour un flic, est un accident du travail, comme la silicose pour les mineurs de charbon.
[...] Il semblerait que ton copain Jiménez était allé très loin dans son enquête sur les abus et disparitions dans les foyers de protection pour mineurs.
Pour celles et ceux qui aiment le pisco-sour.
D’autres avis sur Babelio.

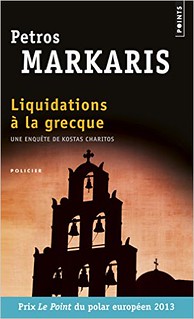
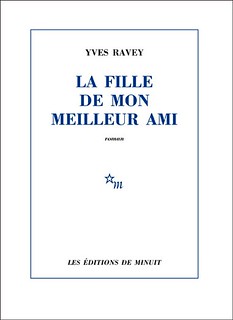
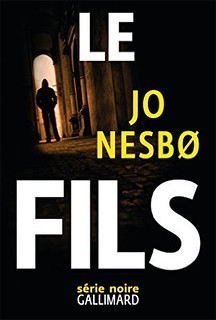
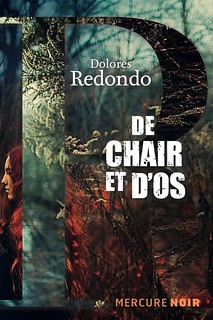
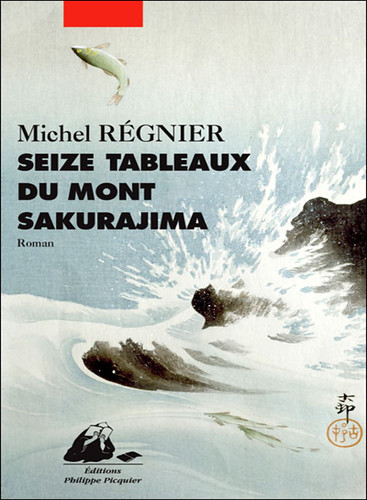

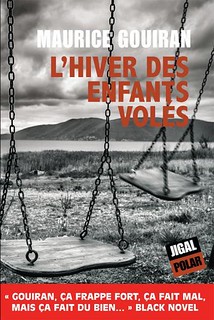
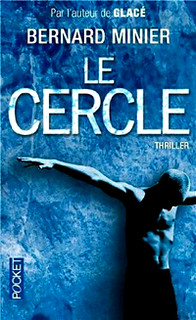



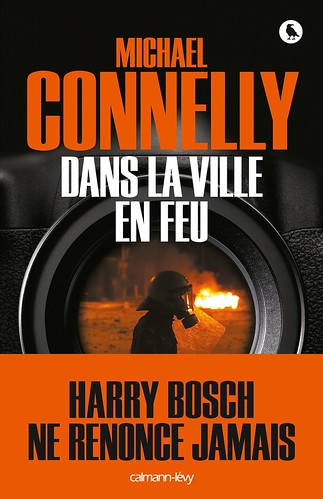
 Hmmmm....
Hmmmm....